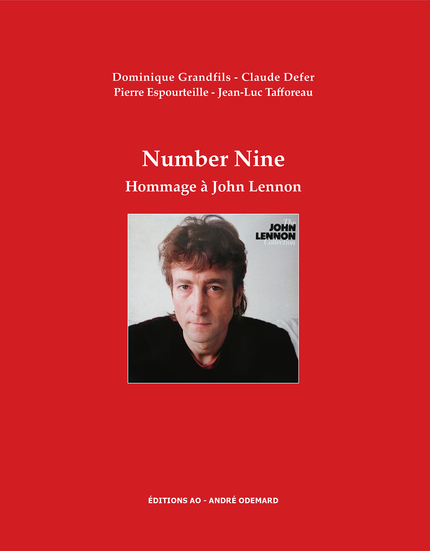Le Champion, une nouvelle de James Holin
Pour Paulina
[Texte mis aimablement à disposition du public par l'auteur et les éditions AO, le 12 avril 2020. Illustrations : photos libres de droits issues de pixabay.com, cf. les liens sous chaque photo]
Voir
la page de James Holin sur le site des éditions AO.
Se lever
https://pixabay.com/images/id-4341624/
La lumière matinale, douce, presque laiteuse, qui pénétrait dans la chambre, coulait depuis les épais rideaux pour s’enfoncer profondément dans la moquette. Antonio da Fonseca ouvrit péniblement un œil tout en conservant le second bien fermé. Il porta doucement le bout de ses longs doigts sur ses pommettes saillantes. Ce rituel d’origine inconnue l’aidait à se réveiller.
L’esprit du Brésilien était comme vidé. À force de changer de continent, de pays, de ville et d’hôtel tous les quinze jours depuis quinze ans, da Fonseca ne savait jamais vraiment où il se trouvait au réveil. Il se concentra pour rassembler ses idées. Progressivement, les éléments se remirent en place comme les pièces d’un puzzle.
On était le 10 juillet 1988, le jour de la course. Dans quelques heures, au début de l’après-midi, da Fonseca serait à bord de la Ferrari n°1 sur la grille de départ. À la cinquième position. Il partirait pour les soixante-cinq tours d’un circuit de haute vitesse de quatre kilomètres sept. Le Grand Prix de formule 1 de Grande-Bretagne à Silverstone.
Les maudites images revinrent alors subrepticement. Il aurait espéré y échapper, au moins en cette journée, mais non. La même vision depuis quinze jours le poursuivait. Des images surgies de nulle part, qui s’imposaient, d’abord la nuit pendant le sommeil, puis progressivement le matin et maintenant à tout moment de la journée, en fait quand bon leur semblaient.
C’était toujours le même film. Da Fonseca se retrouvait au soixante-deuxième tour de ce grand prix de Grande-Bretagne, à trois encore de l’arrivée. Il était en deuxième position, juste derrière la Lotus noire de Nigel Evans. Sa Ferrari rutilante pourchassait le Britannique depuis plus d’une heure vingt et le rattrapait enfin. S’efforçant de le coller au plus près, il cherchait à le dépasser par tous les moyens, à l’affût de la moindre erreur de son concurrent.
Da Fonseca ferma son œil ouvert, inspira profondément en creusant son ventre de chat maigre puis expira bruyamment tout l’air de ses poumons pour chasser ces images au plus loin. Quasi simultanément, il bondit d’un bloc et se réceptionna silencieusement sur ces deux jambes fléchies. Il se retourna lentement et se dirigea vers la salle de bain, enfonçant avec bonheur ses pieds dans la moquette onctueuse.
Face à lui, dans la glace, son regard pénétrant observait un athlète svelte, à la peau cuivrée et aux muscles saillants. Un champion de trente-trois ans, à la chevelure noire, indomptée, dense et bouclée. « Il a la bouche charnue, le teint hâlé et le nez droit, regardez donc son profil, c’est un vrai pâtre grec », disait sa mère en l’embrassant quand il revenait à Noël les bras chargés de cadeaux dans la riche propriété familiale de Sao Paulo. Pour tous, ses coéquipiers, le public, les journalistes et ses adversaires, c’était un coureur hors pair, au style flamboyant, un seigneur qui avait remporté trois fois, avec classe, le Championnat du monde de formule 1.
Le Brésilien continuait à se fixer droit dans les yeux comme s’il eût voulu s’impressionner. Il avança son visage vers la glace et se promit, une nouvelle fois, en susurrant entre ses lèvres mobiles que ces satanées images ne l’empêcheraient pas d’accomplir son devoir. Et, son devoir de champion c’était de courir, de se battre et de gagner. Da Fonseca savait depuis son enfance, depuis que son père avait perdu l’usage de ses jambes lors d’une chute de cheval, que faire son devoir n’était pas facile, mais était la seule chose à faire pour vivre décemment.
Conserver son courage
https://pixabay.com/images/id-3415413/
Le briefing d’avant course aurait dû commencer depuis cinq minutes. On attendait le directeur technique de l’écurie occupé à régler avec le second coureur un problème inopiné d’amortisseur. La dizaine de participants prévus à cette réunion demeuraient debout, à l’arrière de la salle. Ils chuchotaient, jetant à la dérobée des coups d’œil à da Fonseca.
Leur champion en tongs, short blanc et t-shirt bleu, une casquette rouge sur la tête, s’était isolé. Assis seul au premier rang, les yeux fermés, il visualisait le circuit. Légèrement avachi, les épaules rentrées, les bras resserrés, adoptant au mieux la position qu’il occupait dans le cockpit exigu de sa voiture, ses mains actionnaient le volant ergonomique tandis que ses doigts changeaient les sept vitesses de la boîte séquentielle et que ses pieds accéléraient et freinaient.
La femme du Brésilien, Kate Lawson, téléphonait à proximité. Elle accompagnait Antonio à presque tous les grands prix depuis qu’elle ne défilait plus. Ce mannequin australien, blond et élancé, au visage fin et au teint lumineux avait fini par aimer, réellement, cet homme droit, calme et posé, qui se métamorphosait en un compétiteur fougueux, débordant de panache et d’impétuosité une fois en compétition.
Alors que da Fonseca abordait l’entrée du long virage de Woodcote, les images l’assaillirent à nouveau. À deux tours de l’arrivée, la pluie s’était mise à tomber violemment. Profitant d’un changement de vitesse hasardeux de son adversaire, il parvenait enfin à dépasser Nigel Evans en projetant sur ce dernier au passage une magistrale trombe d’eau. Il déposait la Lotus noire à plus de trois cent cinquante kilomètres-heure sur la ligne droite de Pit straight et prenait la tête de la course dans un océan de drapeaux rouges, de hurlements et de cornes de brume.
Da Fonseca rouvrit subitement les yeux. Il ne fallait pas y penser. Il devait trouver en lui la force mentale d’y échapper. De toute manière, qu’il y pensât ou pas, sa décision était prise. Il participerait à la course. Antonio da Fonseca esquissa un sourire en voyant entrer dans la salle le directeur technique et le second coureur de l’écurie, le Belge Tony Hubriant.
Puiser au fond de soi
https://pixabay.com/images/id-1881026/
Da Fonseca aimait ce lieu de concentration extrême qu’était le vestiaire. Il s’y sentait bien. Seul, assis sur un banc de bois verni, baignant dans une lumière tamisée quasi sépulcrale, revêtu de sa combinaison écarlate, son casque jaune et vert dans les mains, ses yeux fixaient un horizon inconnu et inatteignable. Il savourait le silence, une torsion brûlante dans le ventre. À ce stade, il ne visualisait plus rien. Il ne pensait plus à rien. La totalité de son énergie était dirigée vers un point virtuel.
Dès le début du phénomène, il avait évoqué ces images obsédantes à son préparateur physique et mental. Ce dernier lui avait alors dit de ne pas les refouler, mais de les laisser glisser autour de lui, sans s’y arrêter, comme un fluide. « De l’eau sur les plumes d’un canard », avait-il dit.
Ces images ne respectaient rien. Elles s’invitaient à nouveau, n’hésitant pas à profaner ce lieu sacré, Da Fonseca tenta de les faire glisser, mais n’y parvint pas. Le Brésilien entamait le soixante-troisième et avant-dernier tour. Nigel Evans était désormais loin derrière lui. La victoire était à portée de main. Le champion conduisait de manière légère, fluide, très facile. Il entrait naturellement dans les courbes et en sortait avec grâce. Ses trajectoires étaient d’une pureté parfaite.
Le Brésilien se leva brusquement, car il refusa de voir la suite. C’était un champion, il devait concourir quoi qu’il en soit. Il devait gagner, c’était sa mission, sa vocation. Il prit ses gants blancs, mit sa casquette rouge et plaça son casque sous son bras. Quand il ouvrit la dernière porte, celle qui donnait sur la piste, il fut accueilli par une énorme clameur et la lumière aveuglante du soleil. Les images s’évanouirent.
Courir coûte que coûte
https://pixabay.com/images/id-490617/
Le tour de chauffe venait de s’achever. Le soleil tapait fort et déjà da Fonseca sentait la sueur lui couler le long du dos. Sa combinaison lui collait à la peau. Il fallait qu’il pense à boire régulièrement par la canule qui traversait la partie inférieure de son casque.
Il se signa et ses mains avancèrent doucement sur le volant. Il y posa d’abord le bout de ses longs doigts comme il faisait chaque matin sur ses pommettes saillantes puis plaça ses paumes dans les emplacements moulés à cet effet. Ses yeux se levèrent vers le feu tricolore.
Le feu rouge s’alluma et les moteurs se mirent à vrombir dans un vacarme assourdissant. Quand il passerait au vert, il faudrait vite enclencher les vitesses, les unes après les autres, déboîter, se faufiler et remonter le plus à l’avant possible. Un bon départ était fondamental. Da Fonseca en grand professionnel le savait, mieux que personne. De sa cinquième position, il faudrait qu’il remonte au moins jusqu’à la troisième place au terme du premier tour s’il voulait avoir une chance de gagner la course.
Le feu ne resta rouge que quelques secondes, mais cela laissa suffisamment de temps aux dernières images du rêve pour se faufiler. « Non, pas maintenant ! » murmura entre ses dents le Brésilien envahi par la rage.
Il dut se voir alors une nouvelle fois sur la piste détrempée, à la sortie du virage de Stowe, le septième virage de ce soixante-cinquième et dernier tour qui devait l’emmener vers la victoire. Il vit sa roue avant mordre le vibreur bicolore marquant la bordure extérieure du virage, sa monospace s’envoler puis retomber sur le tarmac et prendre feu. Il vit ses bras ses se lever devant sa visière pour protéger son visage.
Feu vert. Da Fonseca passa la première, la deuxième et la troisième dans la foulée. En quelques secondes, il était déjà remonté de deux places. À peine cinq cents mètres et il était désormais troisième derrière Manfred et Evans. Il fonçait. Tout se passait comme dans son rêve. Il roulait vite, très vite, sans se poser de questions, sans hésitation. Pourtant à chaque tour, il avait un pincement au cœur quand il abordait le sinistre virage de Stowe. Il se disait à chaque fois que cela se passerait là, à cet emplacement précis.
La réalité rattrapait peu à peu son rêve. Dans la tête de da Fonseca, les images n’apparaissaient plus maintenant qu’en léger décalé. Les deux flux finirent par se superposer parfaitement pour ne faire plus qu’un.
Nigel Evans était le seul encore devant lui à trois tours de l’arrivée. Da Fonseca se rapprocha au plus près de la Lotus noire du Britannique et scruta du coin de l’œil les nuages gris qui s’amoncelaient. Il savait déjà qu’il ne changerait pas de pneus. Comme prévu, le Brésilien doubla Evans à l’avant-dernier tour. La pluie se mit alors à tomber sans que le champion ne marque le moindre étonnement.
Faire confiance à son étoile
https://pixabay.com/images/id-1655778/
Dans le dernier tour, seul en tête, il aborda la longue ligne droite de Hanger Straigth qui débouche sur le virage de Stowe en sachant qu’il allait bientôt mourir. Il eut une pensée pour sa femme Kate et leur fils unique Ruben. Il les imagina heureux dans la grande propriété de Sao Paulo avec sa mère et son père sur son fauteuil roulant. Pourtant, il ne céda en rien à la peur et maintint ferme son pied sur l’accélérateur.
De manière inattendue, à cent mètres de l’entrée du virage de Stowe, des vibrations violentes secouèrent l’habitacle. Le pneu avant droit de la Ferrari venait d’éclater en roulant sur un débris en carbone abandonné par un concurrent. Da Fonseca décèlera, passant brusquement de près de quatre cents à cent kilomètres-heure. Avec une prouesse de virtuose, le champion parvint à stabiliser son véhicule. Les roues du bolide s’enfoncèrent dans le sable du bas-côté et s’immobilisèrent.
Da Fonseca retira son volant, dégrafa son harnais et s’extirpa rapidement du véhicule. Il enjamba la rambarde métallique de sécurité et s’assit sur le talus. Il ne comprenait pas. C’est alors qu’il vit passer dans une trombe d’eau son poursuivant Nigel Evans. Il se prit la tête entre les mains et ferma les yeux. De là où il était, Da Fonseca put entendre la clameur du public qui accueillait la victoire du Britannique. Il sourit, croyant un moment qu’elle lui était adressée.